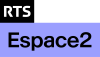Écouter le culte :
Nous célébrons cette année les 450 ans de notre Église française de Bâle. Elle a en effet été fondée par des réfugiés huguenots au lendemain du massacre de la St-Barthélémy en 1572. Nos ancêtres dans la foi ont ainsi tout quitté : leur patrie, parfois leur famille, leurs biens, pour échapper à la mort et ils ont trouvé refuge notamment à Bâle, où ils ont pu tout de suite fonder une paroisse de langue française (avec de la part des autorités de la ville un argument pas très théologique ni humanitaire : vu qu’ils ne comprenaient pas la langue, ils faisaient trop de bruits pendant les cultes allemands et dérangeaient les autres fidèles !). Cette Église continue encore d’exister sans discontinuité durant ces 450 ans ! Faire mémoire de cette histoire ne doit pas nous figer dans une attitude passéiste, mais constitue une responsabilité dans notre présent. Nous pourrions ainsi dire comme les Hébreux installés en terre promise : « Notre père était un huguenot errant ».
Il semble que cette confession de foi, « Notre Père était un araméen errant », soit la plus vieille confession de foi de la Bible. Dans la terre promise, cette terre qui ruisselle de lait et de miel, dans la prospérité donc, le peuple doit se rappeler d’où il vient, faire mémoire de son esclavage, de sa libération par Dieu et de son exode. Le plus grand danger est l’installation, l’enracinement.
Par le don à Dieu des prémisses des récoltes associé à cette confession de foi, le peuple se rappelle que cette terre où il réside est toujours un don de Dieu et non un dû ou une possession. C’est aussi le sens de la très belle fête des « cabanes » ou des « tentes », Sukkot, qui rappelle le temps de la vie sous les tentes dans le désert et valorise le provisoire et la précarité. Par ces rites et ces fêtes, les Hébreux rappellent leur identité, inscrite dans leur nom hébreu – ivrim : ceux qui traversent, ceux qui passent, et évidemment ce rappel a une dimension éthique, notamment quant à l’accueil des étrangers motivé par le souvenir de l’esclavage en Egypte.
Nos commémorations vont dans ce sens : il est intéressant de considérer les modifications de notre Église au courant de l’histoire. C’est le signe d’une Église qui a su s’adapter et évoluer, mais on peut y lire aussi le signe de la fidélité de Dieu. Église de réfugiés d’abord, puis Église des notables et grandes familles bâloises attirées par la langue française (« mondanisation »). Église ensuite des Romands « exilés » pour leur travail et ouverture enfin depuis quelques années aux Africains francophones, comme nous pouvons l’entendre dans ce culte avec notre chorale africaine.
Nous avons par cette histoire la responsabilité particulière de vivre au sein de notre communauté cette dimension interculturelle et de servir de pont entre notre Église cantonale et les autres Églises de migration de Bâle. Ainsi, nous pouvons en tant que paroisse nous sentir comme des « étrangers et voyageurs sur la terre » comme l’affirme l’épître aux Hébreux avec l’exemple d’Abraham.
Abraham est appelé à vivre un déracinement en quittant son pays, un détachement en laissant sa famille, un délestage en abandonnant ses idoles pour une marche à l’aveugle (« sans savoir où il allait ») vers la terre de la promesse. Et même, une fois la terre atteinte, il y vit « comme un étranger », littéralement paroikia, à côté de la maison, c’est-à-dire en décalage, dans les marges.
Intéressant de voir que c’est le terme qui a donné en français « paroisse » ! Dans la terre promise, il continue d’habiter sous la tente (allusion à la fête des tentes) et il demeure un étranger et un voyageur sur la terre de la promesse et ne se transforme pas en un indigène et un sédentaire ! La terre promise reste de l’ordre de la précarité et du provisoire.
La promesse est toujours en avant et nous pousse à un exode continuel. On ne peut arrêter la marche, on ne peut s’installer. Avouons que spontanément, le terme «paroisse» évoque pour nous l’installation géographique, la stabilité, une dimension centrale : «l’église au milieu du village» et pas tellement la marginalité, le mouvement. C’est peut-être important de redécouvrir cette dimension-là, alors que nous sommes tentés de nous lamenter sur la perte de notre attractivité et sur notre marginalisation de la société. Une chance à saisir pour vivre d’autres formes communautaires, dans la confiance en la fidélité de Dieu.
Mais « être étrangers et voyageurs sur la terre » ne se limite pas à notre vie d’Église. Il y a une dimension sociale plus large et aussi une dimension personnelle et intime. Nous voyons que notre société est traversée par des tentations identitaires très fortes ! On parle de racines, et même de « racines chrétiennes », ce qui me semble, à la lumière de nos textes d’aujourd’hui, une totale contradiction ! Et on cherche alors à bétonner une identité fermée en favorisant la peur face à la menace de tout ce qui pourrait venir la déstabiliser. Il y a là un retour à l’enracinement, à l’englobant, à l’attachement pour se sécuriser qui est à l’opposé de l’idéal biblique du nomadisme. «Mon père était un araméen errant» dit bien que notre origine est dans un exode et un exil !
Mais si nous pouvons être tentés parfois de nous raccrocher à ces formes d’identités fermées qui nous sécurisent, c’est que vivre en « exode » n’est pas une facilité : les détachements, qu’ils soient volontaires ou imposés, peuvent faire mal ; l’errance, le non-savoir, la non-maîtrise sont très déstabilisants, vivre toute sa vie comme un don de Dieu, un signe de la grâce et recevoir son identité dernière de Dieu seul est désécurisant. La tentation est alors grande de cesser la marche, de s’installer dans une maîtrise de notre vie, de nous « faire un nom », c’est-à-dire de construire notre identité par nous-mêmes au lieu de la recevoir, de chercher des certitudes inébranlables (y compris parfois religieuses) au lieu d’une attitude de confiance qui semble si fragile !
Oui notre danger est de cesser d’être des étrangers et voyageurs sur cette terre en idéalisant le passé dans la nostalgie, en pétrifiant le présent pour se sentir en totale sécurité et en cherchant à avoir la maîtrise de l’avenir.
Alors que la foi nous propose tout autre chose : marcher en nous libérant du passé, en accueillant le don du présent et en ne cherchant pas à nous approprier l’avenir. C’est alors que nous pouvons expérimenter la confiance qui ne peut pas se capitaliser (cf. la manne), mais qui ne cesse de se renouveler à mesure qu’on marche ! Une attitude existentielle que la grande mystique, Mme Guyon, résume par ces mots « laisser le passé dans l’oubli, l’avenir à la Providence et donner le présent à Dieu ».
Nous vivrons ainsi à l’image de Jésus qui « n’a pas où reposer sa tête ». Jésus est en effet un homme totalement libre, détaché de ses origines ethniques, familiales, religieuses, recevant son identité de son Père céleste et vivant dans une totale confiance en ce Père qui veut son bien (cf. le sermon sur la montagne). Il vit une vie nomade qui lui permet les rencontres avec tous, et notamment les marginalisés, pour leur faire redécouvrir leur dignité d’enfant de Dieu. Jésus l’homme parfaitement libre, mais non d’une liberté égoïste qui cherche ses propres intérêts en oubliant les autres (comme on l’entend trop souvent aujourd’hui), mais une liberté décentrée de lui-même pour accomplir la volonté d’amour de Dieu dans le service d’autrui.
Ainsi Jésus, dans les évangiles, est bien « l’homme qui marche » selon le titre d’un magnifique livre de Christian Bobin, et qui nous libère pour que nous puissions marcher à sa suite :
« Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas. À croire que ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. À croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable. À croire que vivre est comme il marche – sans fin.
L'humain est ce qui va ainsi, tête nue, dans la recherche jamais interrompue de ce qui est plus grand que soi. Et le premier venu est plus grand que nous. » (Christian Bobin, L'homme qui marche.)