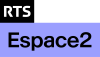Écouter le culte :
C’est l’histoire d’une rencontre, celle de Moïse avec le Seigneur dans le buisson ardent. Au nom de Dieu qui dit : « Je suis qui je suis », et qui brûle sans cesse d'amour sans jamais se consumer ; au nom de ce Dieu-là, Israël – son peuple – va sortir de la servitude égyptienne, il va renaître à la vie.
On se rend compte alors combien l’esclavage et la mort sont liés, car sous l'esclavage, le peuple de Dieu n'a pas d'existence véritable. Dieu fait donc à Moïse l’annonce d’une libération, mais aussi l’annonce de la reprise de la vie !
Et si cette libération d’Israël était la parabole de toute vie humaine ? Ce passage vers la liberté définit sans doute notre aspiration profonde et définit aussi parfois notre histoire personnelle et collective : devenir libre !
Et puis, il y a la mort, la mort qui fait partie de notre vie, qui ne s'évite pas, et qui se traverse. Et c'est là sans doute une des raisons pour lesquelles la génération sortie d'Égypte n'est pas entrée en terre de liberté. Elle est restée couchée dans le désert et ce sont les enfants nés en route qui eux, ont pu passer en terre promise.
Traversée du désert, traversée de la mort. Cette traversée ne peut se faire que dans la confiance en ce feu qui nous conduit, discrètement, et même le plus souvent, secrètement, sans faire de bruit.
Alors oui, nous pouvons dire avec une profonde espérance : la vie en plénitude est encore devant nous, à l'horizon de nos existences, comme la terre promise, qui se profilait dans le lointain seulement. Et il fallait toute une vie (symboliquement, quarante années) pour y parvenir.
Dès lors, avons-nous conscience que nos existences participent déjà à la Vie en plénitude, à la Vie en Dieu, parce qu'elles nous acheminent vers cette Vie sans mélange de mort ? Nous voilà déjà animés et remplis par la Vie qui vient de Dieu et qui nous libère peu à peu du mal – ce mal dont nous demandons la libération à la fin de chaque Notre Père et que l'esclavage en Égypte représente.
Dans l’Évangile de ce matin, il y a des paroles terribles qui font écho à ce que nous trouvons dans les Écritures, des textes qui semblent faire de la souffrance et de la mort une conséquence directe, automatique du péché. Quelque chose que l’Église a beaucoup enseigné. Peut-être avez-vous entendu petits : « C’est le bon Dieu qui t’a puni ! » Parfois c’est inscrit profondément, même si nous n’y croyons plus tellement, c’est encore un peu présent quelque part en nous : « Qu’est-ce que j’ai fait à Dieu pour que cela m’arrive… ? »
Pourtant, dans l’Ancien Testament, il y a Job, cet homme riche qui perd tout : ses biens, sa famille, sa santé. Il est tout près de la mort, et voilà qu’il dira : « Je sais bien que mon rédempteur est vivant, et que, le dernier, il se tiendra debout sur la terre, et moi je le verrai » (Job 19, 25-26). Job refuse cette manière caricaturale de penser que péché = punition, une manière de voir la souffrance qui est terrible. Imaginez qu’on culpabilise une personne subitement victime de maladie ou de malheur : « Ne serait-ce pas de ta faute ? » Terrifiant !
Alors, comme Job, Jésus dans l'Évangile va dire autre chose que cette caricature. Pensez à la cécité de l'aveugle-né dans l’Évangile de Jean, qui n'est due ni à ses péchés ni à ceux de ses parents qui n’auraient pas été ok avec Dieu ! De même, dans l’Évangile du jour, les Galiléens massacrés et les 18 personnes écrasées – on a l’impression d’écouter les actualités quotidiennes – qu’ont-ils donc fait pour être effacés de la vie de cette manière ? Rien. Ils n’ont en rien mérité ce qu’il leur arrive ! Ils ont simplement été victimes de la perversité de Pilate et des mauvais calculs des constructeurs de la tour.
Mais voilà que Jésus continue en disant : « Attention, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » On a l’impression que ça ne joue plus ! Et c’est là, le cœur de cet Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire que se convertir ? Littéralement, tourner son cœur vers Dieu. Ce n’est pas d’abord retrouver une bonne conduite qui plairait à Dieu ou incarner une morale pure ? Qui y arriverait ? Personne. Bien sûr, il y a des exemples magnifiques de vie, mais quand on gratte un peu, personne n’est parfait devant les autres et encore moins devant Dieu !
L’appel à la conversion concerne notre cœur et le trésor qui s’y trouve. La conversion dans l'Évangile, c’est accueillir la foi en cet amour apporté par le Christ, au salut – un mot peu à la mode aujourd’hui, comme si on n’avait plus besoin d’être sauvé. Pourtant la conversion concerne bien un choix, celui de placer notre confiance en Dieu seul. Et s’il y a une morale à respecter, qui peut être bonne pour nous-mêmes et pour les autres, elle vient comme conséquence de notre confiance en Dieu (et non l’inverse). « C’est là le fruit de l'Esprit », dira Paul.
Mais que vient faire le figuier ? Cette toute petite parabole. Lui aussi est pris dans un mystère de vie et de mort, il est à peu près sec. Que fait-on avec un tel arbuste ? En planter un nouveau, ou chercher à lui redonner la vie ?
Dans cette petite parabole, la vie est liée au fruit et la Parole est semée en nous pour que nous portions du fruit dans notre quotidien. Au fond, cette parabole nous parle d’engendrement, de création. Nous ne sommes vivants que lorsque nous créons quelque chose, que lorsque nous engendrons quelque chose ou quelqu’un. Bien sûr, il y a les enfants, mais tout le monde n’a pas d’enfant. Et pourtant nous sommes tous et toutes capables d’engendrer, dans les petites choses de la vie comme dans les grands choix de la vie.
C’est là un vocabulaire très connu : on dit d’Einstein qu’il est le « père » de la théorie de la relativité. Un auteur « accouche » d'un livre, une journaliste « pond » un article… Des verbes qui parlent d’engendrement, du fait de donner la vie. Et on pourrait dire que ce même vocabulaire s’applique à n’importe quelle entreprise humaine qui construit une petite chose : des gestes, des paroles, des regards, une écoute, rendre un endroit accueillant pour les autres, honorer son travail, lutter contre la misère ou le mépris.
On pourrait dire que celui ou celle qui ne fait rien exister dans le monde est figure de mort. Vous savez, quelqu’un d’avancé en âge, qui a le sentiment de ne plus servir à rien et qui attend d’être rappelé par Dieu, pourrait avoir le sentiment de ne plus rien engendrer, et c’est dur !
Mais jusqu’au dernier souffle, avons-nous conscience que nous pouvons engendrer encore, c’est-à-dire accueillir, penser aux autres, prier pour quelqu’un… Des petites choses possibles à tout moment de notre vie.
Pour terminer, dire encore que la parabole du figuier ajoute quelque chose d'important : lorsque nous sommes confrontés à nos manques d’engendrement, lorsque nous nous sentons incapables, fatigués, las, et que nous nous disons : « Je n’engendre ni ne crée rien, je ne dais que survivre », n’oublions jamais que nous ne sommes pas seuls, que Dieu sait attendre. Et comme dans la parabole du figuier stérile, Dieu se met au travail pour nous rendre vie.
Dieu, lui, ne se fatigue pas de reprendre le chemin avec nous. Et il le fait, en vue de la Vie qu’il promet.
Amen.